|
|
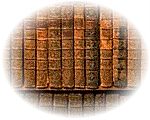 |
|
|
|
||
D'ALEMBERT: article GENEVE et article COLLEGE. |
||
DAMILAVILLE: article PAIX et article POPULATION. |
||
DIDEROT: article ENCYCLOPEDIE et article AUTORITE POLITIQUE |
||
DUMARSAIS: article PHILOSOPHE. |
||
D'HOLBACH: article PRÊTRE et article REPRESENTANT. |
||
JAUCOURT: articles PEUPLE, PRESSE et EGALITE NATURELLE. |
||
QUESNAY: article GRAIN. |
||
ROUSSEAU: article ECONOMIE. |
||
TRONCHIN: article INOCULATION. |
||
|
|
||
|
|
||
|
GENEVE C'est une chose très singulière, qu'une ville qui compte à peine 24 000 âmes, et dont le territoire morcelé ne contient pas trente villages, ne laisse pas d'être un État souverain, et une des villes les plus florissantes de l'Europe: riche par sa liberté et son commerce, elle voit souvent autour d'elle tout en feu sans jamais s'en ressentir. Les événements qui agitent l'Europe ne sont pour elle qu'un spectacle dont elle jouit sans y prendre part: attachée aux Français par ses alliances et par son commerce, aux Anglais par son commerce et par la religion, elle prononce avec impartialité sur la justice des guerres que ces deux nations puissantes se font l'une à l'autre, quoiqu'elle soit d'ailleurs trop sage pour prendre aucune part à ces guerres, et juge tous les souverains de l'Europe, sans les flatter, sans les blesser et sans les craindre.[...] On ne souffre point à Genève de comédie: ce n'est pas qu'on y désapprouve les spectacles en eux-mêmes; mais on craint, dit-on, le goût de parure, de dissipation et de libertinage, que les troupes de comédiens répandent parmi la jeunesse. Cependant ne serait-il pas possible de remédier à cet inconvénient, par des lois sévères et bien exécutées sur la conduite des comédiens? Par ce moyen, Genève aurait des spectacles et des mœurs, et jouirait de l'avantage des uns et des autres: les représentations théâtrales formeraient le goût des citoyens, et leur donneraient une finesse de tact, une délicatesse de sentiment qu'il est très difficile d'acquérir sans ce secours; la littérature en profiterait, sans que le libertinage fit des progrès, et Genève réunirait à la sagesse de Lacédémone la politesse d'Athènes. Une autre considération digne d'une république si sage et si éclairée, devrait peut-être l'engager à permettre les spectacles. Le préjugé barbare contre la profession de comédien, l'espèce d'avilissement où nous avons mis ces hommes si nécessaires au progrès et au soutien des arts, est certainement une des principales causes qui contribuent au dérèglement que nous leur reprochons: ils cherchent à se dédommager par les plaisirs, de l'estime que leur état ne peut obtenir. Parmi nous, un comédien qui a des mœurs est doublement respectable; mais à peine lui en sait-on quelque gré. Le traitant qui insulte à l'indigence publique et qui s'en nourrit, le courtisan qui rampe, et qui ne paie point ses dettes, voilà l'espèce d'hommes que nous honorons le plus. Si les comédiens étaient non seulement soufferts à Genève, mais contenus d'abord par des règlements sages, protégés ensuite, et même considérés dès qu'ils en seraient dignes, enfin absolument placés sur la même ligne que les autres citoyens, cette ville aurait bientôt l'avantage de posséder ce qu'on croit si rare, et ce qui ne l'est que par notre faute, une troupe de comédiens estimable. Ajoutons que cette troupe deviendrait bientôt la meilleure de l'Europe; plusieurs personnes pleines de goût et de disposition pour le théâtre, et qui craignent de se déshonorer parmi nous en s'y livrant, accourraient à Genève, pour cultiver non seulement sans honte, mais même avec estime, un talent si agréable et si peu commun. Le séjour de cette ville, que bien des Français regardent comme triste par la privation des spectacles, deviendrait alors le séjour des plaisirs honnêtes, comme il est celui de la philosophie et de la liberté; et les étrangers ne seraient plus surpris de voir que dans une ville où les spectacles décents et réguliers sont défendus, on permette des farces grossières et sans esprit, aussi contraires au bon goût qu'aux bonnes mœurs. Ce n'est pas tout: peu à peu l'exemple des comédiens de Genève, la régularité de leur conduite, et la considération dont elle les ferait jouir, serviraient de modèle aux comédiens des autres nations, et de leçon à ceux qui les ont traités jusqu'ici avec tant de rigueur et même d'inconséquence. On ne les verrait pas d'un côté pensionnés par le gouvernement, et de l'autre un objet d'anathème; nos prêtres perdraient l'habitude de les excommunier, et nos bourgeois de les regarder avec mépris; et une petite république aurait la gloire d'avoir réformé l'Europe sur ce point, plus important peut-être qu'on ne pense. |
||
| Retour aux Encyclopédistes | ||
|
COLLEGE Ce plan d'études irait, je l'avoue, à multiplier les maîtres et le temps de l'éducation. Mais : 1°) Il me semble que les jeunes gens, en sortant plus tard du collège, y gagneraient de toutes manières s'ils en sortaient plus instruits; 2°) les enfants sont plus capables d'application et d'intelligence qu'on ne le croit communément; j'en appelle à l'expérience; et si, par exemple, on leur apprenait de bonne heure la géométrie, je ne doute point que les prodiges et les talents précoces en ce genre ne fussent beaucoup plus fréquents: il n'est guère de science dont on ne puisse instruire l'esprit le plus borné, avec beaucoup d'ordre et de méthode; mais c'est là pour l'ordinaire par où l'on pèche; 3°) Il ne serait pas nécessaire d'appliquer tous les enfants à tous ces objets à la fois; on pourrait ne les montrer que successivement; quelques-uns pourraient se borner à un certain genre; et dans cette quantité prodigieuse, il serait bien difficile qu'un jeune homme n'eût de goût pour aucun. Au reste, c'est au gouvernement, comme je l'ai dit, à faire changer là-dessus la routine et l'usage; qu'il parle, et il se trouvera assez de bons citoyens pour proposer un excellent plan d'études. Mais en attendant cette réforme, dont nos neveux auront peut-être le bonheur de jouir, je ne balance point à croire que l'éducation des collèges, telle qu'elle est, est sujette à beaucoup plus d'inconvénients qu'une éducation privée où il est beaucoup plus facile de se procurer les diverses connaissances dont je viens de faire le détail. Je sais qu'on fait sonner très haut deux grands avantages en faveur de l'éducation des collèges: la société et l'émulation; mais il me semble qu'il ne serait pas impossible de se les procurer dans l'éducation privée, en liant en-semble quelques enfants à peu près de la même force et du même âge. [...] Un autre inconvénient de l'éducation des collèges est que le maître se trouve obligé de proportionner sa marche au plus grand nombre de ses disciples, c'est-à-dire aux génies médiocres; ce qui entraîne pour les génies plus heureux une perte de temps considérable. |
||
| Retour aux Encyclopédistes | ||
|
|
||
|
PAIX. La
guerre est un fruit de la dépravation des hommes; c'est
une maladie convulsive et violente du corps politique, il n'est
en santé, c'est-à-dire dans son état naturel
que lorsqu'il jouit de la paix; c'est elle qui donne de la vigueur
aux empires; elle maintient l'ordre parmi les citoyens; elle
laisse aux lois la force qui leur est nécessaire; elle
favorise la population, l'agriculture et le commerce; en un mot
elle procure aux peuples le bonheur qui est le but de toute société.
La guerre au contraire dépeuple les États; elle
y fait régner le désordre; les lois sont forcées
de se taire à la vue de la licence qu'elle introduit;
elle rend incertaines la liberté et la propriété
des citoyens; elle trouble et fait négliger le commerce;
les terres deviennent incultes et abandonnées. Jamais
les triomphes les plus éclatants ne peuvent dédommager
une nation de la perte d'une multitude de ses membres que la
guerre sacrifie; ses victoires même lui font des plaies
profondes que la paix seule peut guérir. Si la raison gouvernait les hommes, si elle avait sur les chefs des nations l'empire qui lui est dû, on ne les verrait point se livrer inconsidérément aux fureurs de la guerre, ils ne marqueraient point cet acharnement qui caractérise les bêtes féroces. Attentifs à conserver une tranquillité de qui dépend leur bonheur, ils ne saisiraient point toutes les occasions de troubler celle des autres; satisfaits des biens que la nature a distribués à tous ses enfants, ils ne regarderaient point avec envie ceux qu'elle a accordés à d'autres peuples; les souverains sentiraient que des conquêtes payées du sang de leurs sujets, ne valent jamais le prix qu'elles ont coûté. Mais par une fatalité déplorable, les nations vivent entre elles dans une défiance réciproque; perpétuellement occupées à repousser les entreprises injustes des autres, ou à en former elles-mêmes, les prétextes les plus frivoles leur mettent les armes à la main, et l'on croirait qu'elles ont une volonté permanente de se priver des avantages que la Providence ou l'industrie leur ont procurés. Les passions aveugles des princes les portent à étendre les bornes de leurs États; peu occupés du bien de leurs sujets, ils ne cherchent qu'à grossir le nombre des hommes qu'ils rendent malheureux. Ces passions allumées ou entretenues par des ministres ambitieux, ou par des guerriers dont la profession est incompatible avec le repos, ont eu dans tous les âges les effets les plus funestes pour l'humanité. L'histoire ne nous fournit que des exemples de paix violées, de guerres injustes et cruelles, de champs dévastés, de villes réduites en cendres. L'épuisement seul semble forcer les princes à la paix; ils s'aperçoivent toujours trop tard que le sang du citoyen s'est mêlé à celui de l'ennemi; ce carnage inutile n'a servi qu'à cimenter l'édifice chimérique de la gloire du conquérant, et de ses guerriers turbulents; le bonheur de ses peuples est la première victime qui est immolée à son caprice ou aux vues intéressées de ses courtisans. |
||
| Retour aux Encyclopédistes | ||
|
POPULATION L'esprit des grandes monarchies est contraire à la grande population. C'est dans les gouvernements doux et bornés, où les droits de l'humanité seront respectés, que les hommes seront nombreux.[...] Il n'est point de gouvernement où l'on ne pût en tirer les mêmes avantages. La tyrannie fait des esclaves et des déserts, la liberté fait des sujets et des provinces [...]. Des armées trop nombreuses occasionnent la dépopulation, les colonies la produisent aussi. Ces deux causes ont le même principe, l'esprit de conquête et d'agrandissement. Il n'est jamais si vrai que cet esprit ruine les conquérants comme ceux qui sont conquis, que dans ce qui concerne les colonies. On a dit qu'il ne fallait songer à avoir des manufactures que quand on n'avait plus de friches, et l'on a dit vrai; il ne faut songer à avoir des colonies que quand on a trop de peuple et pas assez d'espace. Depuis l'établissement de celles que possèdent les puissances de l'Europe, elles n'ont cessé de se dépeupler pour les rendre habitées, et il en est fort peu qui le soient; si l'on en excepte la Pennsylvanie, qui eut le bonheur d'avoir un philosophe pour législateur, des colons qui ne prennent jamais les armes, et une administration qui reçoit sans aucune distinction de culte tout homme qui se soumet aux lois. |
||
| Retour aux Encyclopédistes | ||
|
|
||
|
ENCYCLOPÉDIE,
s.f. (Philosoph.). Ce mot signifie enchaînement de connaissances;
il est composé de la préposition grecque ev,
en, et des substantifs kuklov, cercle, et paideia,
connaissance. En effet, le but d'une Encyclopédie est de rassembler les connaissances éparses sur la surface de la terre; d'en exposer le système général aux hommes avec qui nous vivons, et de le transmettre aux hommes qui viendront après nous; afin que les travaux des siècles passés n'aient pas été des travaux inutiles pour les siècles qui succéderont; que nos neveux, devenant plus instruits, deviennent en même temps plus vertueux et plus heureux, et que nous ne mourions pas sans avoir bien mérité du genre humain.[ ... ]. Une considération, surtout, qu'il ne faut point perdre de vue, c'est que si l'on bannit l'homme ou l'être pensant et contemplateur de dessus la surface de la terre, ce spectacle pathétique et sublime de la nature n'est plus qu'une scène triste et muette. L'univers se tait; le silence et la nuit s'en emparent. Tout se change en une vaste solitude où les phénomènes inobservés se passent d'une manière obscure et sourde. C'est la présence de l'homme qui rend l'existence des êtres intéressante; et que peut-on se proposer de mieux dans l'histoire des êtres, que de se soumettre à cette considération? [ ...] Nous avons vu que cette forme alphabétique, qui nous ménageait à chaque instant des repos, qui répandait tant de variété dans le travail, et qui, sous ces points de vue, paraissait si avantageuse à suivre dans un long ouvrage, avait ses difficultés qu'il fallait surmonter à chaque instant. Nous avons vu qu'elle exposait à donner aux articles capitaux une étendue immense, si l'on y faisait entrer tout ce qu'on pouvait assez naturellement espérer d'y trouver; ou à les rendre secs et appauvris, si, à l'aide des renvois, on les élaguait, et si l'on en excluait beaucoup d'objets qu'il n'était pas possible d'en séparer. Nous avons vu combien il était important et difficile de garder un juste milieu. Nous avons vu combien il échappait de choses inexactes et fausses; combien on en omettait de vraies. Nous avons vu qu'il n'y avait qu'un travail de plusieurs siècles, qui pût introduire entre tant de matériaux rassemblés, la forme véritable qui leur convenait; donner à chaque partie son étendue; réduire chaque article à une juste longueur; supprimer ce qu'il y a de mauvais; suppléer ce qui manque de bon, et finir un ouvrage qui remplît le dessein qu'on avait formé, quand on l'entreprit. Mais nous avons vu que de toutes les difficultés, une des plus considérables, c'était de le produire une fois, quelqu'informe qu'il fût, et qu'on ne nous ravirait pas l'honneur d'avoir surmonté cet obstacle. Nous avons vu que l'Encyclopédie ne pouvait être que la tentative d'un siècle philosophe; que ce siècle était arrivé; que la renommée, en portant à l'immortalité les noms de ceux qui l'achèveraient, peut-être ne dédaignerait pas de se charger des nôtres; et nous nous sommes sentis ranimés par cette idée si consolante et si douce, qu'on s'entretiendrait aussi de nous, lorsque nous ne serions plus. |
||
| Retour aux Encyclopédistes | ||
|
AUTORITE POLITIQUE:
La liberté est un présent du ciel, et
chaque individu de la même espèce a le droit d'en
jouir aussitôt qu'il jouit de la raison. Si la nature a
établi quelque autorité, c'est la puissance paternelle:
mais la puissance paternelle a ses bornes; et dans l'état
de nature elle finirait aussitôt que les enfants seraient
en état de se conduire. Toute autre autorité vient d'une autre origine que la nature... On la fera toujours remonter à l'une de ces deux sources: ou la force et la violence de celui qui s'en est emparé: ou le consentement de ceux qui s'y sont soumis [...] La puissance qui s'acquiert par la violence n'est qu'une usurpation ; ...en sorte que ceux qui obéissent deviennent à leur tour les plus forts, et qu'ils secouent le joug, ils le font avec autant de droit et de justice que l'autre qui le leur avait imposé. La même loi qui a fait l'autorité la défait alors: c'est la loi du plus fort. La puissance qui vient du consentement des peuples suppose nécessairement des conditions qui en rendent l'usage légitime, utile à la société... et qui la fixent et la restreignent entre des limites; car l'homme ne doit ni ne peut se donner... sans réserve… à un maître supérieur..., à qui seul il appartient tout entier. C'est Dieu, dont le pouvoir est toujours immédiat sur la créature, maître aussi jaloux qu'absolu [...] Ce n'est pas l'État qui appartient au prince, c'est le prince qui appartient à l'État ; mais il appartient au prince de gouverner dans l'État parce... qu'il s'est engagé envers les peuples à l'administration des affaires, et que ceux-ci de leur côté se sont engagés à lui obéir conformément aux lois. En un mot, la couronne, le gouvernement et l'autorité publique, sont des biens dont le corps de la nation est propriétaire et dont les princes sont les usufruitiers, les ministres et les dépositaires. |
||
| Retour aux Encyclopédistes | ||
|
|
||
|
PHILOSOPHE Les autres hommes sont déterminés à agir sans sentir, ni connaître les causes qui les font mouvoir, sans même songer qu'il y en ait. Le philosophe au contraire démêle les causes autant qu'il est en lui, et souvent même les prévient, et se livre à elles avec connaissance: c'est une horloge qui se monte, pour ainsi dire, quelquefois elle-même. Ainsi il évite les objets qui peuvent lui causer des sentiments qui ne conviennent ni au bien-être, ni à l'être raisonnable, et cherche ceux qui peuvent exciter en lui des affections convenables à l'état où il se trouve. La raison est à l'égard du philosophe ce que la grâce est à l'égard du chrétien. La grâce détermine le chrétien à agir; la raison détermine le philosophe. Les autres hommes sont emportés par leurs passions, sans que les actions qu'ils font soient précédées de la réflexion: ce sont des hommes qui marchent dans les ténèbres; au lieu que le philosophe, dans ses passions mêmes, n'agit qu'après la réflexion; il marche la nuit, mais il est précédé d'un flambeau. La vérité n'est pas pour le philosophe une maîtresse qui corrompe son imagination, et qu'il croie trouver partout; il se contente de la pouvoir démêler où il peut l'apercevoir. Il ne la confond point avec la vraisemblance; il prend pour vrai ce qui est vrai, pour faux ce qui est faux, pour douteux ce qui est douteux, et pour vraisemblance ce qui n'est que vraisemblance. Il fait plus, et c'est ici une grande perfection du philosophe, c'est que lorsqu'il n'a point de motif pour juger, il sait demeurer indéterminé [...] L'esprit philosophique est donc un esprit d'observation et de justesse, qui rapporte tout à ses véritables principes; mais ce n'est pas l'esprit seul que le philosophe cultive, il porte plus loin son attention et ses soins. L'homme n'est point un monstre qui ne doive vivre que dans les abîmes de la mer ou dans le fond d'une forêt les seules nécessités de la vie lui rendent le commerce des autres nécessaire et dans quelqu'état où il puisse se trouver, ses besoins et le bien-être l'engagent à vivre en société. Ainsi la raison exige de lui qu'il connaisse, qu'il étudie, et qu'il travaille à acquérir les qualités sociables. Notre philosophe ne se croit pas en exil dans ce monde; il ne croit point être en pays ennemi; il veut jouir en sage économe des biens que la nature lui offre; il veut trouver du plaisir avec les autres; et pour en trouver, il faut en faire ainsi il cherche à convenir à ceux avec qui le hasard ou son choix le font vivre et il trouve en même temps ce qui lui convient: c'est un honnête homme qui veut plaire et se rendre utile. La Plupart des grands à qui les dissipations ne laissent pas assez de temps pour méditer, sont féroces envers ceux qu'ils ne croient pas leurs égaux. Les philosophes ordinaires qui méditent trop, ou plutôt qui méditent mal, le sont envers tout le monde; ils fuient les hommes, et les hommes les évitent. Mais notre philosophe qui sait se partager entre la retraite et le commerce des hommes, est plein d'humanité. C'est le Chrémès de Térence qui sent qu'il est un homme, et que la seule humanité intéresse à la mauvaise ou à la bonne fortune de son voisin. Homo sum, humani a me nihil alienum puto. Il serait inutile de remarquer ici combien le philosophe est jaloux de tout ce qui s'appelle honneur et probité. La société civile est, pour ainsi dire, une divinité pour lui sur la terre; il l'encense, il l'honore par la probité, par une attention exacte à ses devoirs, et par un désir sincère de n'en être pas un membre inutile ou embarrassant. Les sentiments de probité entrent autant dans la constitution mécanique du philosophe, que les lumières de l'esprit. Plus vous trouverez de raison dans un homme, plus vous trouverez en lui de probité. Au contraire où règnent le fanatisme et la superstition, règnent les passions et l'emportement. Le tempérament du philosophe, c'est d'agir par esprit d'ordre ou par raison; comme il aime extrêmement la société, il lui importe bien plus qu'au reste des hommes de disposer tous ses ressorts à ne produire que des effets conformes à l'idée d'honnête homme. Cet amour de la société si essentiel au philosophe, fait voir combien est véritable la remarque de l'empereur Antonin : "Que les peuples seront heureux quand les rois seront philosophes, ou quand les philosophes seront rois!" Le vrai philosophe est donc un honnête homme qui agit en tout par raison, et qui joint à un esprit de réflexion et de justesse les mœurs et les qualités sociales. Entez un souverain sur un philosophe d'une telle trempe, et vous aurez un parfait souverain. |
||
| Retour aux Encyclopédistes | ||
|
|
||
|
PRÊTRES,
S. m. pi. (Religion et Politique). On désigne sous ce
nom tous ceux qui remplissent les fonctions des cultes religieux
établis chez les différents peuples de la terre. Le culte extérieur suppose des cérémonies, dont le but est de frapper les sens des hommes, et de leur imprimer de la vénération pour la divinité à qui ils rendent leurs hommages. La superstition ayant multiplié les cérémonies des différents cultes, les personnes destinées à les remplir ne tardèrent point à former un ordre séparé, qui fut uniquement destiné au service des autels; on crut que ceux qui étaient chargés de soins si importants, se devaient tout entiers à la divinité; dès lors ils partagèrent avec elles le respect des humains. Il était difficile à des hommes si révérés de se tenir longtemps dans les bornes de la subordination nécessaire au bon ordre de la société: le sacerdoce enorgueilli de son pouvoir, disputa souvent les droits de la royauté; les souverains soumis eux-mêmes, ainsi que leurs sujets, aux lois de la religion, ne furent point assez forts pour réclamer contre les usurpations et la tyrannie de ses ministres; le fanatisme et la superstition tinrent le couteau suspendu sur la tête des monarques; leur trône s'ébranla aussitôt qu'ils voulurent réprimer ou punir des hommes sacrés, dont les intérêts étaient confondus avec ceux de la divinité; leur résister fut une révolte contre le ciel; toucher à leurs droits, fut un sacrilège; vouloir borner leur pouvoir, ce fut saper les fondements de la religion. Tels ont été les degrés par lesquels les prêtres du paganisme ont élevé leur puissance. [...] Les peuples eussent été trop heureux, si les prêtres de l'imposture eussent seuls abusé du pouvoir que leur ministère leur donnait sur les hommes; malgré la soumission et la douceur, si recommandées par l'évangile, dans des siècles de ténèbres, on a vu des prêtres du dieu de paix arborer l'étendard de la révolte; armer les mains des sujets contre leurs souverains; ordonner insolemment aux rois de descendre du trône; s'arroger le droit de rompre les liens sacrés qui unissent les peuples à leurs maîtres; traiter de tyrans les princes qui s'opposaient à leurs entreprises audacieuses; prétendre pour eux-mêmes une indépendance chimérique des lois, faites pour obliger également tous les citoyens. Ces vaines prétentions ont été cimentées quelquefois par des flots de sang: elles se sont établies en raison de l'ignorance des peuples, de la faiblesse des souverains, et de l'adresse des prêtres: ces derniers sont souvent parvenus à se maintenir dans leurs droits usurpés; dans les pays où l'affreuse inquisition est établie, elle fournit des exemples fréquents de sacrifices humains, qui ne le cèdent en rien à la barbarie de ceux des prêtres mexicains. Il n'en est point ainsi des contrées éclairées par les lumières de la raison et la philosophie, le prêtre n'y oublie jamais qu'il est un homme, sujet et citoyen. |
||
| Retour aux Encyclopédistes | ||
|
REPRESENTANT Pour maintenir le concert qui doit toujours subsister entre les souverains et leurs peuples, pour mettre les uns et les autres à couvert des attentats des mauvais citoyens, rien ne serait plus avantageux qu'une constitution qui permettrait à chaque ordre de citoyens de se faire représenter; de parler dans les assemblées qui ont le bien général pour objet. Ces assemblées, pour être utiles et justes, devraient être composées de ceux que leurs possessions rendent citoyens, et que leur état et leurs lumières mettent à portée de connaître les intérêts de la nation et les besoins des peuples; en un mot c'est la propriété qui fait le citoyen, tout homme qui possède dans l'état, est intéressé au bien de l'état, et quel que soit le rang que des conventions particulières lui assignent, c'est toujours comme propriétaire, c'est en raison de ses possessions qu'il doit parler, ou qu'il acquiert le droit de se faire représenter.[...] Nul ordre de citoyens ne doit jouir pour toujours du droit de représenter la nation, il faut que de nouvelles élections rappellent aux représentants que c'est d'elle qu'ils tiennent leur pouvoir. Un corps dont les membres jouiraient sans interruption du droit de représenter l'état, en deviendrait bientôt le maître ou le tyran. |
||
| Retour aux Encyclopédistes | ||
|
|
||
|
PEUPLE Il ne reste donc dans la masse du peuple que les ouvriers et les laboureurs. Je contemple avec intérêt leur façon d'exister; je trouve que cet ouvrier habite ou sous le chaume, ou dans quelque réduit que nos villes lui abandonnent, parce qu'on a besoin de sa force. Il se lève avec le soleil, et, sans regarder la fortune qui rit au-dessus de lui, il prend son habit de toutes les saisons, il fouille nos mines et nos carrières, il dessèche nos marais, il nettoie nos rues, il bâtit nos maisons, il fabrique nos meubles; la faim arrive, tout lui est bon; le jour finit, il se couche durement dans les bras de la fatigue.[...] Qui croirait qu'on a osé avancer de nos jours cette maxime d'une politique infâme, que de tels hommes ne doivent point être à leur aise, si l'on veut qu'ils soient industrieux et obéissants? Si ces prétendus politiques, ces beaux génies pleins d'humanité, voyageaient un peu, ils verraient que l'industrie n'est nulle part si active que dans les pays où le petit peuple est à son aise, et que nulle part chaque genre d'ouvrage ne reçoit plus de perfection.[...] A l'égard de l'obéissance, c'est une injustice de calomnier ainsi une multitude infinie d'innocents; car les rois n'ont point de sujets plus fidèles, et, si j'ose le dire, de meilleurs amis. Il y a plus d'amour public dans cet ordre peut-être, que dans tous les autres; non point parce qu'il est pauvre, mais parce qu'il sait très bien, malgré son ignorance, que l'autorité et la protection du prince sont l'unique gage de sa sûreté et de son bien-être; enfin, parce qu'avec le respect naturel des petits pour les grands, avec cet attachement particulier à notre nation pour la personne de ses rois, ils n'ont point d'autres biens à espérer. |
||
| Retour aux Encyclopédistes | ||
|
PRESSE
(Droit polit.). On demande si la liberté de la presse
est avantageuse ou préjudiciable à un État.
La réponse n'est pas difficile. Il est de la plus grande
importance de conserver cet usage dans tous les États
fondés sur la liberté: je dis plus, les inconvénients
de cette liberté sont si peu considérables vis-à-vis
de ses avantages, que ce devrait être le droit commun de
l'univers, et qu'il est à propos de l'autoriser dans tous
les gouvernements.[...] Enfin, rien ne peut tant multiplier les séditions et les libelles dans un pays où le gouvernement subsiste dans un état d'indépendance, que de défendre cette impression non autorisée, ou de donner à quelqu'un des pouvoirs illimités de punir tout ce qui lui déplaît; de telles concessions de pouvoir dans un pays libre, deviendraient un attentat contre la liberté; de sorte qu'on peut assurer que cette liberté serait perdue dans la Grande-Bretagne, par exemple, au moment que les tentatives de la gêne de la presse réussiraient; aussi n'a-t-on garde d'établir cette espèce d'inquisition. |
||
| Retour aux Encyclopédistes | ||
|
ÉGALITÉ
NATURELLE (Droit Nat.) est celle qui est entre les
hommes par la constitution de leur nature seulement. Cette égalité
est le principe et le fondement de la liberté [...]. Puisque la nature humaine se trouve la même dans tous les hommes, il est clair que, selon le droit naturel, chacun doit estimer et traiter les autres comme autant d'êtres qui lui sont naturellement égaux, c'est-à-dire, qui sont hommes aussi bien que lui. [...] 1. Il résulte de ce principe, que tous les hommes sont naturellement libres, et que la raison n'a pu les rendre dépendants que pour leur bonheur. 2. Que, malgré toutes les inégalités produites dans le gouvernement politique par la différence des conditions, par la noblesse, la puissance, les richesses, etc., ceux qui sont les plus élevés au-dessus des autres, doivent traiter leurs inférieurs comme leur étant naturellement égaux, en évitant tout outrage, en n'exigeant rien au-delà de ce qu'on leur doit et en exigeant avec humanité ce qui leur est dû le plus incontestablement. 3. Que quiconque n'a pas acquis un droit particulier, en vertu duquel il puisse exiger quelque préférence, ne doit rien prétendre plus que les autres, mais au contraire les laisser jouir également des mêmes droits qu'il s'arroge à lui-même. 4. Qu'une chose qui est de droit commun, doit être ou commune en jouissance, ou possédée alternativement, ou divisée par égales portions entre ceux qui ont le même droit, ou par compensation équitable et réglée.[...] Cependant qu'on ne me fasse pas le tort de supposer que, par un esprit de fanatisme, j'approuvasse dans un État cette chimère de l'égalité absolue, que peut à peine enfanter une république idéale; je ne parle ici que de l'égalité naturelle des hommes; je connais trop la nécessité des conditions différentes, des grades, des honneurs, des distinctions, des prérogatives, des subordinations qui doivent régner dans tous les gouvernements. [...] Dans l'état de nature, les hommes naissent bien dans l'égalité, mais ils n'y sauraient rester; la société la leur fait perdre, et ils ne redeviennent égaux que par les lois. [...]" |
||
| Retour aux Encyclopédistes | ||
|
|
||
|
GRAINS
(Économie Polit.). Les principaux objets du commerce en
France sont les grains, les vins et eaux-de-vie, le sel, les
chanvres et les lins, les laines, et les autres produits que
fournissent les bestiaux; les manufactures des toiles et des
étoffes communes peuvent augmenter beaucoup la valeur
des chanvres, des lins et des laines, et procurer la subsistance
à beaucoup d'hommes qui seraient occupés à
des travaux si avantageux. Mais on s'aperçoit aujourd'hui
que la production et le commerce de la plupart de ces denrées
sont presque anéantis en France. Depuis longtemps les
manufactures de luxe ont séduit la nation; nous n'avons
ni la soie ni les laines convenables pour fabriquer les belles
étoffes et les draps fins; nous nous sommes livrés
à une industrie qui nous était étrangère;
et on y a employé une multitude d'hommes dans le temps
que le royaume se dépeuplait et que les campagnes devenaient
désertes. On a fait baisser le prix de nos blés
afin que la fabrication et la main-d'œuvre fussent moins
chères que chez l'étranger: les hommes et les richesses
se sont accumulés dans les villes; l'agriculture, la plus
féconde et la plus noble partie de notre commerce, la
source des revenus du royaume, n'a pas été envisagée
comme le fond primitif de nos richesses; elle n'a paru intéresser
que le fermier et le paysan: on a borné leurs travaux
à la subsistance de la nation qui, par l'achat des denrées,
paye les dépenses de la culture; et on a cru que c'était
un commerce ou un trafic établi sur l'industrie, qui devait
apporter l'or et l'argent dans le royaume. Ce sont les grands revenus qui procurent les grandes dépenses; ce sont les grandes dépenses qui augmentent la population, parce qu'elles étendent le commerce et les travaux et qu'elles procurent des grains à un grand nombre d'hommes. Ceux qui n'envisagent les avantages d'une grande population que pour entretenir de grandes armées jugent mal de la force d'un État. Les militaires n'estiment les hommes qu'autant qu'ils sont propres à faire des soldats; mais l'homme d'État regrette les hommes destinés à la guerre comme un propriétaire regrette la terre employée à former le fossé qui est nécessaire pour conserver le champ. Les grandes armées l'épuisent; une grande population et de grandes richesses le rendent redoutable. Les avantages les plus essentiels qui résultent d'une grande population sont les productions et la consommation, qui augmentent ou font mouvoir les richesses pécuniaires du royaume. Plus une nation qui a un bon territoire et un commerce facile est peuplée, plus elle est riche: et plus elle est riche, plus elle est puissante. |
||
| Retour aux Encyclopédistes | ||
|
|
||
|
ECONOMIE Après avoir parlé de l'économie générale par rapport au gouvernement des personnes, il nous reste à la considérer par rapport à l'administration des biens. Cette partie n'offre pas moins de difficultés à résoudre, ni de contradictions à lever que la précédente. Il est certain que le droit de propriété est le plus sacré de tous les droits de citoyens, et plus importants à certains égards que la liberté même; soit parce que les biens étant plus faciles à usurper; et plus pénibles à défendre que la personne, on doit plus respecter ce qui se peut ravir plus aisément; soit enfin parce que la propriété est le vrai fondement de la société civile, et le vrai garant des engagements des citoyens: car si les biens ne répondaient pas des personnes, rien ne serait si facile que d'éluder ses devoirs, et de se moquer des lois. |
||
| Retour aux Encyclopédistes | ||
|
|
||
|
INOCULATION, s. f. (Chirurgie, Médecine, Morale,
Politique). Ce nom synonyme d'insertion, a prévalu pour
désigner l'opération par laquelle on communique
artificiellement la petite vérole, dans la vue de prévenir
le danger et les ravages de cette maladie contractée naturellement.
[...] La petite vérole artificielle préserve de la contagion, tout comme la petite vérole naturelle; et s'il était vrai, ce qui n'a pas encore été décidé, qu'il y eût quelques exceptions à cette règle générale, on y pourrait tout au plus en conclure que la prudence prend quelquefois des précautions inutiles. L'inoculation ne communique aucune autre maladie, quoique la preuve n'en soit que négative; qui est-ce qui ne s'en contentera pas? La chose n'est pas susceptible d'une preuve positive. Trente années d'observations, dont aucune jusqu'à présent ne l'invalide, doivent nous tranquilliser; où est d'ailleurs le médecin sage qui n'exige pas qu'on soit attentif sur le choix du pus dont on se sert pour inoculer? Si après tout ce qui a été dit et écrit sur cette matière, il était besoin d'encouragements, la petite vérole naturelle nous les donnerait en foule. C'est aux vrais médecins, et le nombre en est bien petit, à apprécier les compliments que les adversaires de l'inoculation leur prodiguent; ils avoueront tous d'une voix que, dans les grandes épidémies, les ressources de l'art sont trop petites, et les billets mortuaires n'en font que trop foi. Que serait-ce si on ajoutait que peut-être l'art même rend la mortalité plus grande, et que la petite vérole est de toutes les maladies celle qu'on traite le plus mal ? |
||
| Retour aux Encyclopédistes | ||
|
Merci à ANTOINE SEGALOV pour l'aide apportée lors de la correction des textes après numérisation. |
||
|
|
||
|
|
||