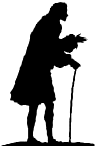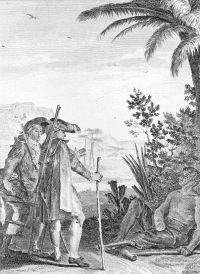|
|
|
|
|
|
VOLTAIRE |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
Nom:
AROUET (dit Voltaire)
Prénom: François-Marie
Dates de naissance et de mort
: 1694-1778
Profession:
homme de lettres, historien
et philosophe
|
|
|
|
|
|
|
|
"Il a fallu
des siècles pour rendre justice à l'humanité,
pour sentir qu'il est horrible que le grand nombre semât
et que le petit nombre recueillît."
Lettres philosophiques
|
|
|
|
|
|
|
Fils
d'un notaire parisien, François-Marie Arouet qui prendra
plus tard le nom de Voltaire a fait ses études au collège
Louis-Le-Grand, sous la férule des maîtres Jésuites.
Il se fait rapidement une réputation d'homme d'esprit
dans la société libertine du palais du Temple.
A 22 ans, ses écrits satiriques sur les amours du régent
lui valent un premier exil, puis onze mois d'emprisonnement à
la Bastille. Libéré, il adopte le pseudonyme de
Voltaire et sa première tragédie, Oedipe
(1718), connaît le succès. Mais à la suite
d'une dispute avec le Chevalier Rohan-Chabot, il est à
nouveau embastillé puis en exil à Londres de 1726
à 1729. Là, il "apprend à penser"
en lisant Bacon, Locke et Newton.
A son retour en France, il est ce qu'il ne cessera plus d'être:
historien et philosophe. Il publie des tragédies comme
Brutus (1730) et Zaïre (1732) qui le font
apparaître comme le digne successeur de Corneille et Racine,
mais ses Lettres philosophiques ou Lettres anglaises
(1734), véritable "bombe lancée contre
l'ancien régime" sont brûlées par décision
du parlement de Paris et Voltaire est contraint une nouvelle
fois à l'exil, à Cirey, chez la marquise du Châtelet,
où il restera jusqu'en 1744 et auprès de qui il
approfondit ses connaissances scientifiques. Un court séjour
à Paris lui permet de publier Le Mondain, un poème
satirique, qui lui vaudra encore un court exil, en Hollande cette
fois.
De 1744 à 1747, protégé par Madame de Pompadour,
il triomphe enfin à la cour, devient historiographe du
roi Louis XV et est élu à l'académie française.
Il connaît bientôt la disgrâce et se réfugie
alors à la cour de Frédéric II, roi de Prusse.
Là, il connaît une intense période de création
et projette même d'écrire avec son protecteur une
"Encyclopédie de la Raison", plus militante
que l'Encyclopédie de Diderot: c'est l'ébauche
du futur Dictionnaire philosophique. Mais la faveur royale
ne dure pas, Voltaire s'installe alors à Genève,
puis à Ferney, à la frontière franco-suisse.
|
|
|
|
|
L'errance
s'achève. Voltaire va faire de Ferney un petit royaume
exemplaire: il y développe une agriculture moderne, y
installe l'industrie, prospère grâce au commerce.
L'énergie qu'il déploie d'autre part, pour faire
réhabiliter des victimes du fanatisme, parfait l'image
rapidement légendaire du patriarche de Ferney,
bienfaiteur de l'humanité (Traité sur la tolérance,
affaire Calas ). Les grandes œuvres publiées au cours
des vingt-cinq dernières années (l'Essai sur
les mœurs, le Dictionnaire philosophique) prolongent
ces entreprises concrètes pour faire triompher la Raison. |
|
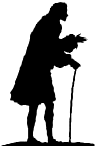 |
Son retour à Paris au début du règne
de Louis XVI suscite une manifestation d'enthousiasme populaire,
sa pièce Irène (1778) connaît un triomphe.
Il meurt deux mois plus tard, le 30 mai 1778. En 1794, le peuple
de Paris le conduira solennellement au Panthéon. |
|
|
|
|
|
|
|
Principales oeuvres:
|
|
|
|
|
|
|
|
Oedipe (1718): tragédie.
La Ligue (1723): poème
épique.
La Henriade (1728):
épopée.
Histoire de Charles XII
(1731): histoire.
Zaïre (1732): tragédie.
Lettres philosophiques ou
Lettres anglaises (1734):
cette oeuvre met en relief les avantages de la liberté
dans tous les domaines: religion, politique, économie,
philosophie, science et littérature et affirme une conception
d'un bonheur terrestre déiste et laïc.
Le Mondain (1736):
poème satirique.
Eléments de la philosophie
de Newton; Discours sur l' Homme
(1738).
Mahomet (1741): tragédie.
La mort de César
(1743): tragédie.
Zadig ou la Destinée
(1748): conte
philosophique: Dans un Orient de mille et une nuits, un jeune
homme apprend la sagesse en perdant d'abord un œil, puis
ses illusions. Différentes aventures le montrent occupé
de politique, où ses essais pour faire justice à
la raison lui valent quelquefois des désagréments
; en luttant contre les différents abus, il devient philosophe,
et finit roi.
Le siècle de Louis XIV
(1751).
Micromégas
(1752): conte philosophique.
Poème sur le désastre
de Lisbonne; Essai
sur les moeurs (1756)
|
|
|
Candide ou l' Optimisme
(1759): conte philosophique: "Le monde
est bon", dit Pangloss ; mais son élève le
jeune Candide ne cesse de faire l'expérience du contraire:
le mal a l'avantage sur le bien, l'absurde règne, le désordre
est omniprésent. Le pessimisme de Voltaire trouve ici
son expression la plus achevée, et en même temps
la plus tonique. Un espoir demeure : la seule morale possible
en cet univers de précarité et d'incertitude semble
bien de "cultiver son jardin".
|
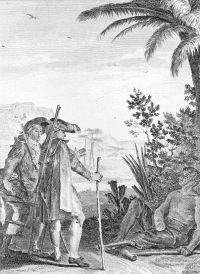 |
|
Illustration pour Candide
par Moreau le Jeune (1787). |
|
|
|
Traité sur la Tolérance
(1763)
Dictionnaire philosophique portatif
(1764)
Nouveaux Mélanges,
dont De l' horrible danger de la lecture
(1765)
L' Ingénu (1767): conte
philosophique.
Questions sur l' Encyclopédie
(1770)
Epître à Horace
(1772)
Irène (1778): tragédie.
|
|
|
|
|
|
|
Page réalisée
par FARID OULABBI
Recherche des textes en
ligne : VANESSA SCWEITZER & PRISCILLIA PAPON
Recherche iconographique: FARID OULABBI & le professeur. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HAUT DE PAGE |
RETOUR |